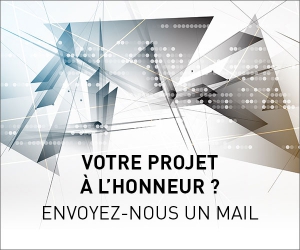“Un plus grand bureau a plus de poids”
Fin décembre, UMAN Architect fêtait son deuxième anniversaire. Un âge auquel un bureau d’architectes ne peut généralement pas avoir encore de réalisations notables à son actif. Les co-associés Pierre Poncelet et Fabrizio Tengattini – également président de l’UWA – admettent préférer regarder l’avenir. Dans le cas d’UMAN, cependant, il est intéressant de jeter un œil en arrière. Le bureau liégeois rassemble 40 ans d’expérience, une stratégie ciblée et la quête qui l’accompagne. ...